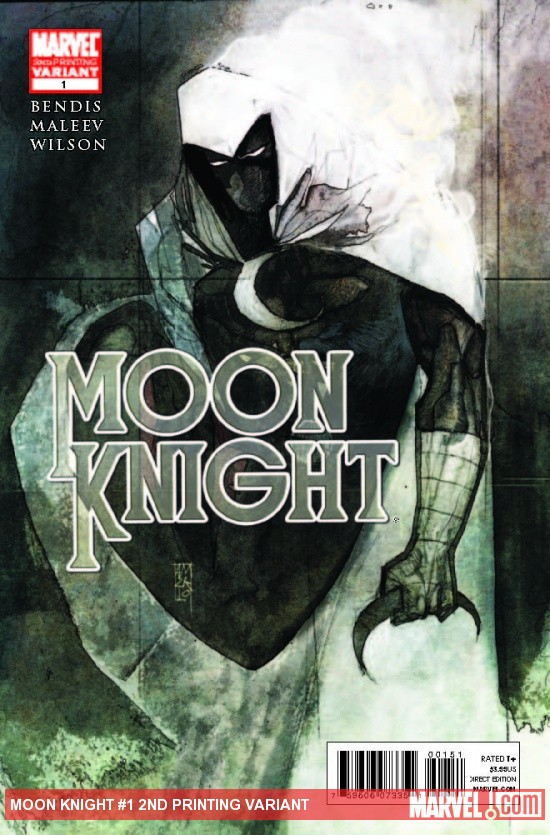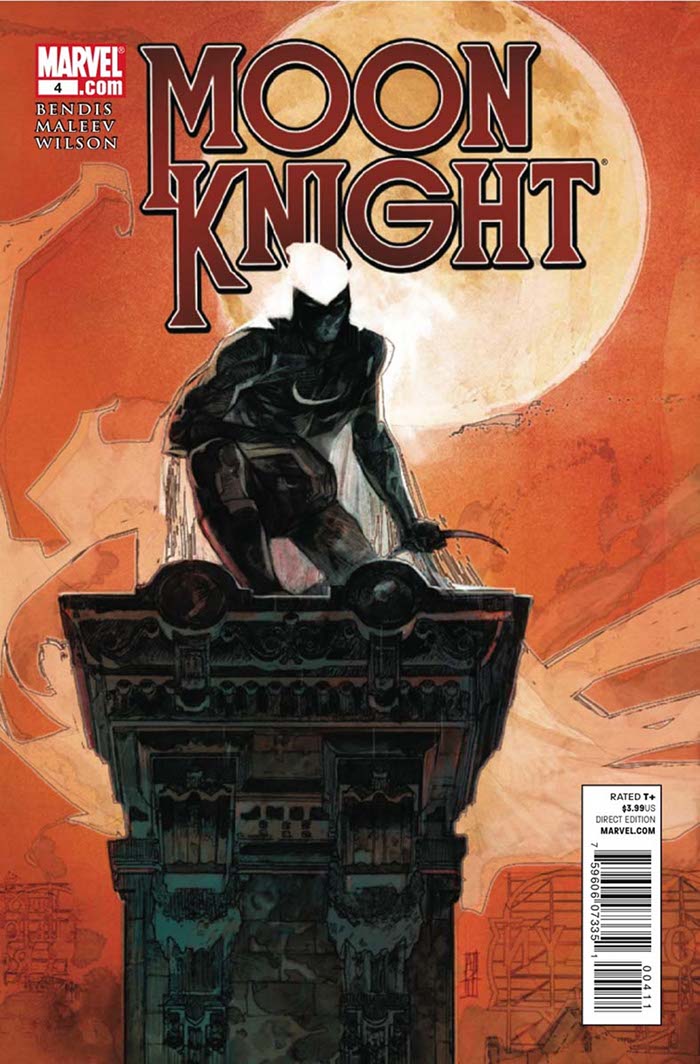La Librairie Préambule a le plaisir de recevoir
l'écrivain Serge Koster mercredi 19 septembre à partir de 11 h. Bien
connu des fidèles du Printemps du livre pour ses animations savoureuses,
Serge Koster est aussi l’auteur de nombreux ouvrages (essais et
romans), dont le dernier, "Je ne mourrai pas tout entier" (Éditions Léo
Scheer - 2012) s'apparente à une sorte de livre testament, des
fragments, des méditations, des souvenirs... la vie d'un homme de
lettres.
Une citation :
"D'où me vient le goût
d'écrire ? De l'enfance. De l'insuffisance du sentiment d'exister. De la
pénurie de caresses. Mais encore, d'où vous vient le goût d'écrire ? Du
désir de naître, de se faire connaître, reconnaître, renaître, être né.
Et de ne pas mourir tout entier."
Une critique de Jérome Garcin :
Grâce à Léautaud,
il s'est révélé sur le tard. La preuve avec ce nouveau recueil de
souvenirs où Serge Koster, 72 ans, continue d'écrire sous le manteau
élimé du vieux diariste de Fontenay-aux-Roses. Qu'importe à ce juif
d'origine polonaise que Léautaud eût été judéophobe: sa dette à son
égard est plus forte que les reproches dont il pourrait l'accabler. Sans
l'auteur atrabilaire du «Journal littéraire», jamais l'austère Koster
n'aurait osé se mettre à nu, se préférer, se mal aimer, avouer sa
vanité, abandonner la fiction pour l'égotisme, faire la liste de toutes
ses maladies (dont une fistule anale), exprimer son amertume d'être
méconnu, peu lu et très pilonné, reconnaître avoir écrit quelques
livres «inconsistants»,
vitupérer le milieu littéraire qui l'a
souvent négligé, ou donner les noms de ceux avec qui, pour des vétilles
et le goût de se fâcher, il s'est brouillé.
Mais la gratitude dont ce livre est plein va bien au-delà de Léautaud.
Ici, Koster glorifie la femme de sa vie, la France qui a accueilli ses
parents en fuite, les paysans sarthois qui l'ont caché pendant la
guerre, son père spirituel Francis Ponge, Claude Lanzmann - «L'avoir
connu est un cadeau du destin» -, ou encore Michel Tournier, avec lequel
il s'est réconcilié en buvant un monaco. Impossible de ne pas être ému
par ce récit d'un écorché vif calmé par la grammaire, d'un fils
d'apatrides dont la littérature a été la seule patrie.
Un témoignage de David Foenkinos :
Je n'avais
jamais lu ses romans, ses essais, ses articles. Je l'ai rencontré il y a
peu au Printemps du livre de Cassis, puisqu'il anime une fois par an,
et depuis 25 ans, les débats de cette manifestation culturelle. « Mon
ultime activité publique » dit-il dans son livre. Avec Antoine Spire,
ils forment un duo étonnant. Avec l'auteur entre eux, ça prend vite fait
la forme d'un hot-dog. On ne sait plus très bien s'il faut tourner la
tête à gauche ou à droite. Mais bon, depuis le temps, ils maîtrisent le
voyage.
Serge Koster m'a touché. C'est difficile de savoir pourquoi quelqu'un
vous touche finalement. C'est un ensemble de choses assez intimes et qui
ne s'écrivent pas. Je l'ai vu assez peu. Quelques bribes de
conversation. Il a parlé d'un voyage à New York avec sa femme ; avec un
petit sourire mignon, il a dit : « on voyage peu, mais là on s'est fait
plaisir ». Ne serait-ce que pour ça, j'ai eu envie de lire son livre. ça
commence par l'évocation de ses funérailles. On pourrait imaginer une
entrée en matière plus joyeuse, et pourtant, tout à son image, elle est
légère et désinvolte comme les musiques choisies. Pour sa mort, il veut
du jazz. Rien d'étonnant, il écrit comme les artistes de chez Blue Note.
J'ai fait des études de Jazz, alors je me reconnais d'entrée des goûts
communs avec cet homme. Ce n'est que le début, tout le livre fut pour
moi une succession d'étrangetés et de correspondances. On dit parfois
quand on a aimé un livre : « ah j'aurais aimé l'écrire ». Moi, son
livre, je crois que j'aurais aimé l'écrire dans quarante ans. Il est
l'avenir de ma vie littéraire. Je l'ai déjà lu deux fois. Il m'a fasciné
par sa beauté, son élégance, sa pudeur. Page 26, il écrit : « Peut-être
suis-je en train d'écrire, encore une fois, un texte sacrifié, sans
destin qu'une minorité de lecteurs ». Il n'a pas eu tort. Je n'ai pas
l'impression que beaucoup ont parlé de ce texte. Je ne sais pas vous,
mais moi ça me touche profondément cette façon d'évoquer un texte
sacrifié, alors chaque ligne bat de la densité la plus totale d'un
homme. Ce que j'aime, c'est l'absence absolue d'aigreur, d'apitoiement,
comme une beauté à la désinvolture que les années nous ont obligés à
endosser.
Le livre fourmille d'anecdotes sur Michel Tournier, Francis Ponge, ou
encore Bernard Giraudeau. Les soirées avec Françoise Verny valent aussi
le détour. On y lit les belles rencontres, les espoirs d'une grande vie
littéraire, les déceptions aussi, les ambitions avortées. C'est le roman
de la vie littéraire. Avec, toujours cette question : que reste-t-il ?
Sûrement, les pages les plus émouvantes sont sur les vieillards croisés
au cours de son existence. Les fins de vie de Jean Dessailly, Claude Roy
ou encore Jean Dutourd (tiens encore un point commun, j'avais raconté
dans ce blog ma rencontre avec Dutourd...). C'est une question à
laquelle je ne cesse de penser. J'ai eu parfois l'impression en lisant
ce livre que Serge Koster m'aidait à formuler la confusion de certains
de mes sentiments. Et puis au cœur de son livre, il y a d'une manière
incessante, le refrain inépuisable : « la femme de ma vie ». Beaucoup de
beauté à ne cesser de mentionner l'acolyte de cette traversée. Je me
suis toujours amusé de cette expression : « la femme de ma vie » qu'on
prononce lors d'une belle rencontre. Mais là, après cinquante ans passés
ensemble, on peut vraiment dire qu'il s'agit de la femme de sa vie. Le
soir, ils aiment lire et échanger leurs impression : « Souvent je
m'interromps, m'allonge, ferme les yeux, étends le bras vers son flanc,
demeure immobile, savourant derechef le sentiment de l'existence à
l'état pur, dans le calme murmure du cosmos, en harmonie avec l'univers,
tout à son plan, qui est de nous réunir pour l'entièreté du temps où
nous serons. A cet instant, la certitude de notre inscription dans le
non-être me laisse incrédule. »
Voilà, alors nous vous attendons nombreux mercredi, pour découvrir son livre.
Amicalement votre
Préambule
Signature mercredi 19 septembre 2012, de 11 h à 13 h, à la librairie Préambule, 8 rue Pierre Eydin - Cassis.
Rens. : 04 42 01 30 83